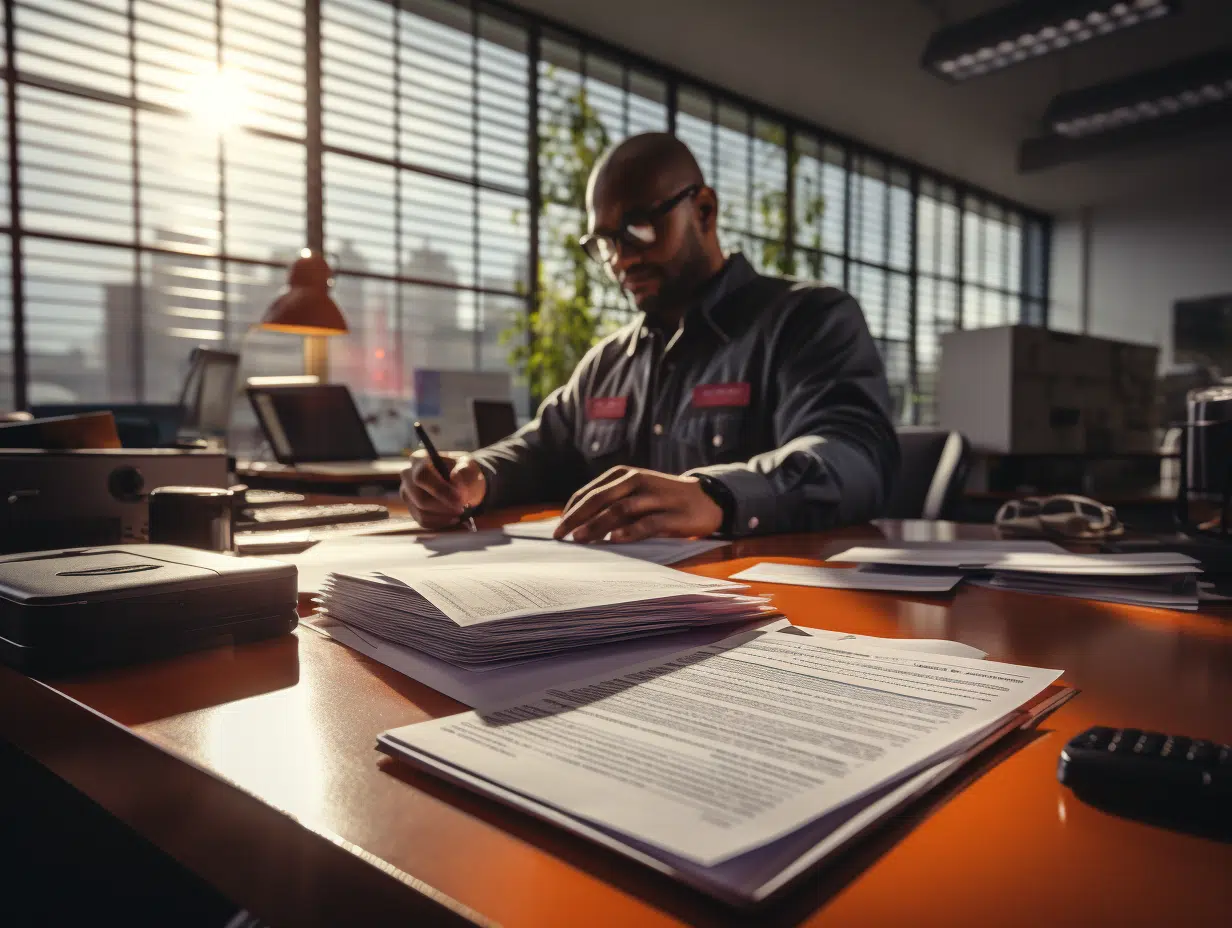2035 n’est pas un mirage lointain. À Paris, la sentence est tombée : les véhicules diesel n’auront plus droit de cité dès 2024. Amsterdam, elle, mise sur 2030. Partout en Europe, la pression s’intensifie : restrictions, dérogations à la carte, calendriers éclatés. Les États membres avancent chacun à leur tempo, tiraillés entre législation nationale et directives de Bruxelles.
La Commission européenne a fixé un cap : d’ici 2035, la vente des voitures thermiques, diesel compris, doit cesser. Des constructeurs ne comptent pas attendre l’ultimatum : certains arrêtent la production de modèles diesel dès 2026 ou 2027. Mais la réalité est plus nuancée : tout dépend de l’âge du véhicule, de son usage, de sa classification Crit’Air. C’est un jeu de pistes réglementaire dont chaque automobiliste doit décoder les règles.
Pourquoi le diesel est-il progressivement interdit en France et en Europe ?
Si le diesel se retrouve dans le viseur des pouvoirs publics, ce n’est pas un simple coup de balai idéologique. La loi climat et résilience a préparé le terrain d’un bouleversement profond de la mobilité sur tout le territoire. L’objectif affiché : faire chuter les émissions polluantes produites par les moteurs thermiques, notamment les diesels. Le ministère de la transition écologique et l’ADEME ne cessent de rappeler le poids des oxydes d’azote et des particules fines sur la santé, surtout dans les grandes villes.
Les grandes agglomérations ont pris la mesure de l’urgence. La généralisation des zones à faibles émissions (ZFE) à Paris, Lyon, Grenoble, Strasbourg s’accélère sous l’impulsion de l’Europe et du Parlement européen. L’accès au centre-ville n’est plus libre : la vignette Crit’Air et sa classification font la loi. Les véhicules anciens, souvent diesel, sont de plus en plus exclus, parfois à certaines heures, parfois lors des pics de pollution.
Ce resserrement réglementaire n’est pas franco-français. Dans toute l’Europe, la pression s’intensifie contre le diesel. Plusieurs pays appliquent des mesures similaires, s’appuyant sur des études sanitaires et la volonté d’aligner la mobilité urbaine sur les ambitions climatiques du continent. Les automobilistes voient les règles évoluer sans cesse, la circulation se jouant désormais sur la conformité aux seuils d’émissions et aux plans d’actions locaux.
Dates clés : ce que prévoient les calendriers d’interdiction du diesel
La marche vers la fin du diesel s’appuie sur un calendrier précis, aussi bien en France qu’en Europe. Les grandes villes jouent les éclaireurs. À Paris, la circulation des voitures diesel immatriculées avant 2006 (Crit’Air 4 et plus) est déjà proscrite à l’intérieur du périphérique. Dès 2025, ce sont tous les diesels, peu importe leur date de sortie d’usine, qui seront concernés dans le Grand Paris.
D’autres métropoles suivent la cadence. Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Reims et Rouen mettent à leur tour la pression avec des ZFE de plus en plus strictes. De 2025 à 2026, la plupart des centres urbains devraient bannir les diesels les plus anciens, avant d’élargir l’exclusion à l’ensemble des modèles, au fil du durcissement des critères Crit’Air.
Sur le plan national et européen, le cap est fixé : le Parlement européen a acté la fin de la vente des véhicules thermiques neufs (diesel compris) pour 2035. Le Royaume-Uni, de son côté, arrêtera la commercialisation dès 2030. En France, impossible d’acheter une voiture diesel neuve après 2035, conformément à la réglementation européenne.
Voici les grandes étapes à retenir dans ce calendrier de l’interdiction du diesel :
- 2024 : restriction des Crit’Air 4 et 5 dans toutes les ZFE
- 2025 : interdiction totale du diesel dans Paris (Grand Paris inclus)
- 2025-2026 : élargissement des interdictions dans les grandes métropoles françaises
- 2030 : fin de la vente au Royaume-Uni
- 2035 : interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs en France et dans l’Union européenne
La trajectoire ne laisse plus de place au doute : le diesel s’efface progressivement des centres urbains, puis du marché automobile, sous l’effet combiné de la réglementation et de la volonté de tourner la page des énergies fossiles.
Quelles conséquences pour les automobilistes et le secteur automobile ?
Pour ceux qui utilisent encore une voiture diesel, le changement s’impose. Les restrictions dans les ZFE se multiplient et la cote des modèles anciens s’effondre. Aujourd’hui, la vignette Crit’Air détermine tout : pour certains, elle ouvre les portes des centres-villes ; pour d’autres, elle les claque définitivement. Les propriétaires de diesels Crit’Air 4 ou 5 voient leurs déplacements limités, leur véhicule difficile à revendre, et doivent parfois réorganiser leur quotidien, voire envisager un changement de véhicule plus tôt que prévu.
Côté assurance auto, les règles bougent aussi. Plusieurs compagnies adaptent leurs contrats : surprimes, exclusions ou garanties limitées pour les modèles qui ne respectent plus la réglementation en vigueur dans les ZFE. Un automobiliste mal informé peut se retrouver démuni en cas de sinistre : lire les petites lignes de son contrat n’a jamais été aussi nécessaire.
Dans les usines, la mue s’accélère. Les constructeurs français et allemands, Peugeot, Renault, Citroën, Volkswagen, réorganisent leur production. Les lignes dédiées au thermique ferment progressivement, l’investissement se concentre désormais sur l’hybride et l’électrique. Stellantis et Mercedes rivalisent d’innovation pour rester dans la course. Le diesel, longtemps star du bitume, cède la place à de nouvelles motorisations.
Pour les professionnels de l’automobile, le virage est rude. Les garagistes et vendeurs de véhicules d’occasion voient leurs stocks de diesels s’accumuler, surtout en zone urbaine. Les clients se détournent du diesel, préférant l’essence, l’hybride ou l’électrique, portés par la crainte de se retrouver avec une voiture impossible à vendre ou à utiliser.
Panorama des alternatives et des stratégies adoptées à travers l’Europe
Le diesel s’efface, mais la mobilité ne s’arrête pas pour autant. Constructeurs et pouvoirs publics expérimentent différentes solutions, chacun en fonction de ses contraintes et de ses ambitions. L’Union européenne trace une direction claire avec l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à l’horizon 2035. Pendant ce temps, les métropoles donnent le tempo en multipliant les ZFE.
Les alternatives prennent la lumière, et chaque pays affine ses choix :
- Véhicule électrique : la star du moment. L’Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas investissent dans des réseaux de recharge puissants et proposent une fiscalité attractive.
- Essence : en France, la part de l’essence grimpe, notamment chez ceux qui hésitent encore à passer à l’électrique.
- Biocarburants et carburants alternatifs : le superéthanol E85 séduit pour son prix et sa large disponibilité. Les professionnels s’intéressent au Gazole B100, au GNV et au GPL-c pour renouveler leurs flottes.
- Hydrogène : la France et l’Allemagne accélèrent sur ce terrain. Paris teste déjà des bus à hydrogène sur certaines lignes urbaines.
Les stratégies varient d’un pays à l’autre. Les États scandinaves accélèrent sur l’électrique, l’Italie et l’Espagne misent sur les biocarburants pour retarder l’échéance, le Royaume-Uni opte pour une sortie rapide avec l’appui des ZFE et d’aides financières. Le paysage de la mobilité européenne reste en perpétuelle évolution.
Dans ce nouvel environnement, les Crit’Air 1 et 2, mais aussi les hybrides et électriques, gagnent du terrain. Les transporteurs adaptent leurs flottes. Les particuliers, eux, scrutent les offres et les aides, tentant de choisir le bon cap dans un marché en pleine mutation.
À mesure que les moteurs diesel s’éteignent, reste une question : quelle silhouette aura la ville de demain, sans la rumeur sourde du gasoil ? La réponse s’écrira au fil des choix de chaque conducteur, chaque ville, chaque pays.